D'après l'article de Arthur Pougin - La Stoltz, L'intermédiaire des chercheurs curieux n°1208, Vol LIX, 1909.
La mystérieuse Madame Stoltz
Grande artiste et intrigante fieffée, la cantatrice célèbre qui se faisait appeler Rosine Stoltz, et qui ne s'appelait ni Stoltz ni Rosine, reste une figure singulièrement énigmatique et dont il est diantrement difficile de retracer l'histoire. Où était-elle née? Quel était son nom? Quel âge avait-elle lorsqu'elle mourut à Paris le 30 juillet 1903 ? Autant de questions qui jusqu'ici sont restées insolubles. Les uns l'ont dite née à Paris en 1815, à moins que ce ne soit en 1813, d'autres en 1818, et en Espagne, d'où sa mère, Française, serait revenue avec elle à Paris, où elle serait devenue concierge d'une maison du boulevard Montparnasse. Ceux-ci l'appellent Rose Niva, ceux-là Victoire ou Victorine Noël, et elle-même s'est prétendue par sa naissance marquise d'Altavilla.
Ainsi commence la biographie que lui consacrait Arthur Pougin en 1909.
Selon la version officielle, Victoire Noël serait née
à Paris le 13 janvier 1815. Elle serait fille de Florentin
Noël et de Clara Stoll, concierges, boulevard Montparnasse. Selon
le Grand Larousse Universel, publié du vivant de la diva, elle se serait
appelée Rosé Niva et serait née en Espagne le 13
février 1813. Elle aurait été amenée
très jeune à Paris, où sa mère,
«
portière d'une maison du boulevard Montparnasse, fut longtemps
connue dans son quartier sous le nom de la mère Noël.»
La coïncidence de son jour de naissance avec celui de la mort du
duc de Berry expliquerait la protection que lui accorda la duchesse.[2]
On l'a dite élevée, grâce aux largesses de la
duchesse, au « Couvent des Bénédictines de la rue du
Regard ». Faute d'un tel couvent, il s'agirait peut-être
plutôt d'un établissement qui, en 1832 existait depuis
plusieurs années au 3, rue du Regard, connu sous la
dénomination d'Orphelines de la Providence.
Victoire-Rosé fut ensuite élève de la
célèbre École classique de Choron, comme Duprez,
Hippolyte Monpou, Scudo, Mme Hébert-Massy, etc. mais elle n'eut
pas le temps d'y terminer son éducation musicale, cette
école ayant été supprimée à la suite
de la révolution de 1830. Alexandre-Etienne Choron (1771-1834),
qui avait ouvert son cours au 69 de la rue de Vaugirard, a
laissé des papiers volumineux, conservés à la
Bibliothèque nationale. Professeur de mathématiques
à l'Ecole polytechnique dès sa fondation, puis membre
correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, il fut chargé
en 1811 de réorganiser les maîtrises avec le titre de
Directeur de la musique des fêtes religieuses. Nommé
directeur de l'Opéra en 1816 il provoqua la réouverture
du Conservatoire, fermé depuis 1815, sous le nom d'Ecole
royale de chant et de déclamation. Dès 1817, il
était congédié, sans pension par suite du trop
grand nombre de changements qu'il avait voulu apporter. C'est alors
qu'il fonda et dirigea l'institution Royale connue sous le nom de " Conservatoire
de musique classique et religieuse" qui devint, après 1830,
le Conservatoire royal de musique classique de France. Choron
mourut à Paris le 24 juin 1834, Son influence artistique fut
considérable et beaucoup de grands artistes passèrent par
son école ou utilisèrent ses conseils. On trouve, dans
ces papiers, qu'à une époque non précisée,
il y avait parmi ses élèves une nommée Noël
appartenant à la 4e classe. Il s'agit peut-être de la
future Rosine Stoltz. En 1829, mais sous le nom de Rosine Niva, elle
prenait part aux célèbres concerts donnés par
Choron dans son établissement. A cette époque elle avait
perdu son père et habitait chez sa mère,
boulangère, 7 rue du faubourg Montmartre. C'est là
qu'elle connut Ternaux, le fils d'un des célèbres
industriels de la place des Victoires et qui semble avoir
été son premier protecteur. Engagée en 1831 par
Cartigny pour le Théâtre du Parc à Bruxelles, c'est
sous le nom de Rosine Ternaux qu'elIe débuta dans une
comédie en vers, les Trois Châteaux, puis dans un
vaudeville, La fille de Dominique.
Après avoir joué en Hollande puis, comme seconde
chanteuse, à Spa sous le nom de Mlle Héloïse, elle
prit à son retour à Anvers, le nom de Stoltz (qui est
à peu près le nom de sa mère: Stoll), auquel elle
adjoignit le prénom de Rosine, souvenir du nom que lui avait
donné son ancien maître ou forme francisée de son
vrai prénom ? C'est en tous cas sous ces noms qu'elle obtint ses
principaux triomphes.

Rosine Stoltz à l'académie royale de musique
d'après une lithographie de Gustave.
Après quelques mois
passés au théâtre d'Anvers, elle se produisit dans
le Pré aux clercs à Lille, puis à
Amsterdam, Anvers, puis encore à Bruxelles, où cette fois
elle tint le grand emploi.
C'est à Bruxelles, le 2 mars 1837, qu'elle convola en justes
noces pour la première fois, avec Auguste Lécuyer, un
avocat de Rouen, mais à la condition de conserver son nom
d'artiste ... et sa liberté. Malgré cette latitude
laissée aux deux époux, ils se séparèrent
judiciairement au bout de quelques années.[3]
Sur la recommandation de Adolphe Nourrit, célèbre
ténor de l'époque, qui avait été
frappé par la beauté de sa voix et l'intensité de
son sentiment dramatique, Rosine Stoltz fut engagée par
Duponchel, directeur de l'Opéra de Paris où elle vint
débuter le 25 août 1837 dans La Juive, pour jouer
ensuite les Huguenots et le Freischutz. En 1840, elle
créa le rôle de Léonor, de La Favorite, écrit spécialement pour sa voix de contralto et qui est
resté son triomphe avec celui d'Odette, dans Charles VI,
et la reine de Chypre, dans l'opéra de ce nom.
On sait la carrière qu'elle fournit à l'Opéra de
Paris et les succès qu'elle y obtint pendant dix années,
carrière qui lui fut peut-être facilitée par la
liaison très intime qu'elle noua avec Léon Pillet, qui
avait succédé comme directeur à Duponchel. Ses
créations furent nombreuses, dans Guido et Ginevra, Benvenulo
Gellini de Berlioz, le Lac des Fées, La Xacarilla, la Favorite, où son triomphe fut éclatant
aux côtés de Duprez, de Barroilhet et de Levasseur, la Reine
de Chypre, le Guerillero, Charles VI, qui mit le
comble à sa renommée, Dom Sebastien de Portugal, le
Lazzarone, Othello, Marie Stuart, l'Etoile de Séville, David,
Robert Bruce.

Mme Stoltz, costume de la favorite
dessin: Antoine Roy lithographie A. Collette. (Gallica-BNF) [4]
Mais La Stoltz, (on disait La Stoltz comme on avait dit La Malibran, comme on dirait La Callas)
égoïste et jalouse, ne voulait de succès que pour
elle seule, et abusait de sa situation auprès de Léon
Pillet pour écarter toutes les cantatrices dont la valeur
pouvait lui porter ombrage. Ainsi avait-elle fait, notamment, pour Mme
Dorus-Gras, qu'elle découragea au point de lui faire quitter
l'Opéra. Le scandale devint tel, qu'elle se fit, en dépit
de son talent, prendre en haine non seulement par ses camarades, mais
par le public, et que les journaux ne se gênaient pas pour
dévoiler et juger avec sévérité sa conduite
sous ce rapport. Un scandale qui se produisit à la
première représentation de Robert Bruce, le 30
décembre 1846, donne la note de la froideur des relations qui
avaient fini par s'établir entre elle et le public. A cette
époque elle relevait d'une assez longue maladie, une « fluxion de
poitrine », qui durant quelques mois l'avait tenue
éloignée du théâtre. Elle faisait sa
rentrée dans le pastiche que, sous ce titre de Robert Bruce,
Gustave Waëz, Alphonse Royer et Niedermeyer avaient arrangé
sur la musique de Rossini. Les habitués de l'Opéra,
à qui la Stoltz était devenue antipathique, ne
désiraient nullement cette rentrée. On parlait
même, à mots couverts, d'une cabale qui se serait
organisée contre elle. Malheureusement pour l'artiste, elle se
trouva donner, fort involontairement, prise à la critique. Soit
que les bruits qui couraient fussent venus jusqu'à son oreille
et l'eussent émue plus qu'il n'eût fallu, soit qu'elle ne
fût pas suffisamment remise de sa récente maladie,
toujours est-il qu'il lui arriva, le jour de la première, un
accident fâcheux, et qu'à un moment, elle détonna
d'une façon formidable. Robert Bruce n'est
qu'une traduction de la célèbre Donna del Lago de
Rossini
au second acte, l'héroïne, Marie, oppressée
par sa tristesse, se lève et commence le bel O quante
lacrimel...
Théophile Gauthier a racconté l'épisode dans une
lettre :
A ce moment, soit que l'émotion de chanter un air si célèbre troublât Mme Stoltz, soit qu'elle se ressentît encore de l'indisposition qui avait retardé la représentation de la pièce, sa voix se mit à baisser et descendit d'un quart de ton. Le public de Paris, qui est certes le plus doux et le plus poli de tous les publics, faisant sans doute la réflexion que Mme Stoltz, à peine relevée d'une fluxion de poitrine, ne pêchait que par excès de zèle, n'eût donné aucune marque de désapprobation et n'eût protesté que par un froid silence, si les romains ne fussent venus tout gâter par des applaudissements intempestifs. Quelques chut! adressés plutôt aux optimistes gagés qu'à la cantatrice, provoquèrent, de la part de ceux-ci, de nouvelles salves de la plus bruyante impertinence les chut! redoublèrent, des sifflets vinrent s'y mêler. Pendant ce temps, Mme Stoltz, pâle, hors d'elle-même, arpentait le théâtre avec des pas et des gestes convulsifs elle paraissait vouloir quitter la scène. Quelques injures de la plus abjecte espèce lui avaient été, dit-on, jetées à bout portant de l'orchestre. Outrée de colère, elle dit, assez haut pour être entendue, de toute la salle, tournée vers la loge directoriale : Mais vous entendez bien qu'on m'insulte!... C'est intolérable! Je suis brisée! Puis, en se dirigeant vers la porte du fond, elle déchira son mouchoir dans un accès de rage silencieuse et en jeta violemment les morceaux par terre. La pièce continua néanmoins, mais au milieu d'une émotion facile à comprendre.
Une partie des spectateurs, qui
ne demandaient sans doute qu'un prétexte pour manifester son
hostilité, s'étaient mis à siffler avec vigueur.
D''autres voulurent applaudir des sifflets plus aigus
répondirent, des altercations s'échangèrent, et
l'on assure même que Mme Stoltz, décontenancée,
pâle de douleur, de dépit et de colère,
reçut de certains, en plein visage, « quelques
épithètes fâcheuses et qui s'adressaient
plutôt à la femme qu'à l'artiste ». Peu
habituée à un tel accueil, la rage au coeur, elle quitta
enfin la scène. Elle reparut cependant et la
représentation put se terminer. Robert Bruce fut
même joué plusieurs fois.
Mais le coup était porté, et la situation de Mme Stoltz
devint bientôt impossible à l'Opéra. Elle le
comprit ou peut être le lui fit-on comprendre et, vers le milieu
du mois de mars 1847, elle adressa la lettre suivante au duc de Coigny,
président de la Commission spéciale des
Théâtres royaux :
Monsieur
le Président,
En butte depuis trop longtemps à des calomnies que je ne puis
supporter, signalée comme un obstacle à
l'avènement de tout talent nouveau, je ne puis résister
au besoin que j'éprouve d'opposer à des accusations
injurieuses la seule réponse qui convienne à mon
caractère. Mon engagement n'expire qu'en juin 1848, mais dans la
disposition où m'ont su mettre des persécutions dont on
reconnaîtra plus tard l'injustice, il m'est tout à fait
impossible de le continuer.
Je l'ai déclaré fermement à M. le directeur et
crois devoir en informer la Commission, bien décidée
à plutôt payer mon dédit que de rester plus
longtemps exposée au soupçon d'être un obstacle
à la prospérité de l'Opéra.
Si je ne consultais que mon désir et mes intérêts,
je n'hésiterais pas à m'éloigner sur le champ
mais je ne veux pas donner l'apparence d'un coup de tête à
une résolution bien mûrement réfléchie. Je
croirais en outre manquer au premier de mes devoirs envers le public et
envers la direction, en entravant le répertoire par un
départ subit. Je continuerai donc loyalement mon service pendant
le temps nécessaire à mon remplacement. S'il faut rester
un mois encore, je resterai, mais, dès à présent,
je mets, quant à moi, tous mes rôles à la
disposition immédiate de toute artiste que l'on jugera
convenable d'y faire débuter.
Auriez-vous, Monsieur le Président, la complaisance de
communiquer cette lettre à la commission, pour qu'aucun de
Messieurs les membres dont elle se compose ne puisse se
méprendre sur la cause de ma résolution?
Agréez Monsieur le duc, l'assurance du respect de votre
très humble servante,
Rosine STOLTZ
Mme Stoltz s'efforçait
de sauver la face, et, par cette lettre rendue publique, de faire
croire que son départ était volontaire. La
vérité est que le ministère, déjà
depuis longtemps fatigué de la situation qu'elle avait
créée à l'Opéra, exigeait devant le
scandale récent, non seulement son départ, mais celui de
Léon Pillet, qui, en effet, quelques semaines après,
remettait le théâtre aux mains de son
prédécesseur Duponchel et de Nestor Rocqueplan.
Mme Stoltz habitait 44, rue Laffitte, à Paris. C’est
à son domicile que son mobilier fût vendu le 26 avril
1847. D’après Cantinjou, parmi les objets vendus
figuraient, un Christ en ivoire sculpté par Jean de Bologne, un
Christ en Bronze, ouvrage de Benvenuto Cellini, un Titien, un
Rembrandt, un Murillo, ... et des toiles de moindre importance du
Bronzino, de Carlo Dolei, de Sasso Ferrato, de Salvator Rosa etc...
Quant à Rosine, elle disparut.
Le 21 janvier 1848, naquit à Paris Charles Raymond Stolz.
Quelques années plus tard, le 11 avril 1865, il fut anobli par
Ernest Il, duc régnant de Saxe-Cobourg & Gotha, et
créé définitivement, le 25 septembre 1868, baron
Stolzenau von Ketschendorf... Les armoiries et la devise
octroyés par Ernest II à Carl Raymond sont au surplus
significatives: D'azur à une harpe d’or (dit Rietstap). Cimier: La harpe entre
un vol d’or, chaque aile chargée de trois fasces
d’azur. Devise: Vis in corde.
Ernest CarI-Wilhelm-Josef-Hubert de Ketschendorf, né à Cobourg le 3 mai 1873, fils
aîné de Carl Raymond, sera un des déclarants de la
mort de Rosine Stoltz et se reconnaîtra, dans l’acte de
décès, petit-fils de la célèbre cantatrice.
Son père, Carl de Ketschendorf, qui fut conseiller de
légation d’Ernest II, avait des prétentions
littéraires. Il fit paraître sous son nom, à
Bruxelles, en 1869, un gros volume intitulé Archives
judiciaires. Ce recueil de grands procès politiques est, en
réalité, l’oeuvre d’un Belge, Gustave Oppelt
(1817-1888). Rosine Stoltz s'adressera encore au complaisant Oppelt lorsqu’elle voudra, onze
ans plus tard, signer du nom ronflant de princesse de Lesignano,
adopté alors par elle, Les Constitutions de tous les pays
civilisés. L’ouvrage parut à Bruxelles en une
édition superbe, avec le portrait et la signature autographe de
l’auteur, qui en fit remettre, le 5 décembre 1881, un
exemplaire à la classe des lettres de l’Académie
royale de Belgique.

Rosina Stoltz - Baugniet photographe
Gallica BNF
Mais revenons à 1850.
Rosine, reparut et après quelques tournées en province,
obtint de grands succès hors de nos frontières, à
Lisbonne, au théâtre royal de Turin, puis à Rio
où elle devint la " bonne amie" de l'empereur Dom Pedro, qui fit
pour elle, dit-on, de véritables folies. On raconte qu'un jour,
entre autres, pour la représentation donnée à son
bénéfice, il ordonna que l'on couvrit de pétales
de roses le chemin qu'elle devait suivre pour aller de sa demeure au
théâtre, de sorte que sa voiture passait
littéralement sur un lit de roses. Jamais souverain n'avait
été l'objet d'un tel honneur.
Au commencement de 1855, elle était
de retour à Paris, et donnait un petit nombre de
représentations à l'Opéra, où elle joua
particulièrement, le rôle de Fidès, du Prophète que Meyerbeer lui avait destiné à l'origine. Puis elle
quitta définitivement le théâtre, du moins pour son
compte personnel car on assure que lorsque, deux ou trois ans
après, le mime Deburau, deuxième du nom, prit la
direction, aux Champs-Elysées, de l'ancienne petite salle
Marigny à laquelle il donna le nom de Théàtre Deburau,
c'est elle qui fournit les fonds de cette modeste entreprise, et qu'il
y avait à cela des raisons tout intimes..
Car Charles Deburau, loin d’avoir la figure anguleuse de son
père, était gracieux, remplaçant
l’incomparable fantaisie de l’auteur de ses jours par
l’élégance. Charles négligeait son service
au petit théâtre des Funambules, et les recettes
s’en ressentaient. Les relations du mime avec son directeur, qui
était en même temps son tuteur, devinrent de plus en plus
tendues. Un beau jour, le Pierrot envoya tout à fait promener Billion (c'était le nom du
directeur). Il y avait un dédit de 10.500 frs à payer, il
le paya. Aussitôt Charles Deburau entra en pourparlers avec M.
Hiltbrunner, le directeur du théâtre voisin des Délassements-Comiques.
Madame Stoltz apporta à celui-ci 140.000 frs dont 30.000
étaient réservés à la réfection
complète de la salle. Charles était engagé comme
artiste et directeur de la scène pour huit ans, à partir
du 1er novembre 1855 à raison de 8000 frs par an. Rosine Stoltz
avait alors 43 ans, et Charles 27....
Ce fut le coup de grâce pour Billion qui vendit son petit
théâtre des Funambules. Mais l'entreprise des Délassements-Comiques ne réussit pas davantage. La fauvette reprit sont vol, le
pierrot, la clé des champs.
C'est à cette
époque, en 1860, que Rosine Stoltz se fit construire une somptueuse villa au Vésinet. Les plans avaient été
commandés à Pierre Joseph Olive, l'architecte en titre de
MM Pallu & Cie. La Maison de la chanteuse, inspirée
dit-on d'une maison de Pompéi, s'élevait sur la route
n°4, rive Gauche. La voie prit tout naturellement le nom de route
de la Villa Stoltz. Les peintures bibliques qui l'ornaient ont
été préservées et sont aujourd'hui au
musée de Beauvais.
Une dizaine d'années plus tard, la maison fut vendue à Charles Auguste Hériot qui l'occupa jusqu'à sa mort en 1879. Son frère hérita de la propriété et y fit bâtir une autre villa, plus somptueuse encore, La Villa Hériot. Le nom de route de la Villa Stoltz subsista jusqu'en 1890, lorsque le Conseil municipal le changea en route de la Villa Hériot.
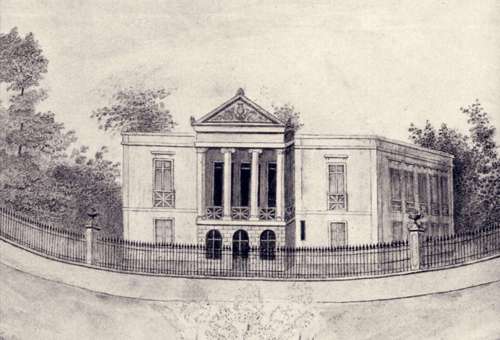
La Villa Stoltz (1861)
Pierre Joseph Olive, architecte.
En 1878, à Pampelune,
Rosine se maria pour la seconde fois, à don Manuel-Louis de
Godoï, prince de Bassano, prince de la Paix. Elle avait avec
ostentation l’orgueil de ces divers titres, comme dans une lettre
d’elle, datée de 1879, qui porte cette signature aussi
étrange que compliquée " Rosa, duchesse et princesse de
Lesignano, princesse de Bassano, de Godoy et de la Paix, baronne et
comtesse de Ketschendorf, née marquise d’Altavilla (Rosa
Stoltz)."
On retrouve dans cette litanie, aux côtés
des titres de son mari, ceux obtenus par son fils et quelques autres
peut-être inventés. On lui a prèté un
troisième mariage avec un prince de Lesignano di San Marino,
sans pouvoir en préciser ni le lieu ni la date.
Rosine mourut dans le superbe hôtel Cosmopolite de l’avenue de
l'Opéra, précisément la veille du jour où
échéait son quartier de pension. De sorte que le convoi
fut plus que modeste...
L’acte de décès fut dressé comme suit:
L’an
mil neuf cent trois, le trente Juillet à midi, Acte de
Décès de Victoire Noël dite Rosina Stoltz, Princesse
Godoy de Bassano, Comtesse de Ketschendorf Veuve en premières
Noces de Alphonse Auguste Lescuyer Veuve en secondes Noces de Godoy,
prince de Bassano née à Paris, y
décédée en son domicile, avenue de l'Opéra,
n°30 ce matin à quatre heures, âgée de
quatre-vingt huit ans et demi fille de Père et de Mère
décédés dont les noms ne Nous sont pas connus.
Dressé par Nous, Charles Joseph Eugène Lavanoux, Adjoint
au Maire, Officier de l'Etat civil du deuxième Arrondissement de
Paris, Officier d’Académie, après constatation, sur
la déclaration de Ernest Charles William de Ketschendorf,
âgé de trente ans, sans profession demeurant à
Londres, Iles Britanniques, petit fils de la défunte, et de
Georges Charles âgé de cinquante ans, EmpIoyé
demeurant Rue Bonaparte, n°7, non parent de la défunte.
Témoins qui ont signé avec nous, après lecture...
En 1909, la Société de l’Histoire du Théâtre prit la décision de renouveler la concession de cinq ans, grâce à laquelle la fameuse cantatrice, créatrice de la Favorite, reposait au cimetière de Pantin, ailleurs que dans la fosse commune, déjà bien oubliée.
****
Notes et sources:
[1] Arthur Pougin - La Stoltz, L'intermédiaire des chercheurs curieux n°1208 Vol LIX ,1909.
[2] Pierre Larousse - Stoltz, Rosine, in Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Paris 1878.
[3]Le fils né de cette union le 21 septembre 1836 (donc avant le mariage célébré le 2 mars 1837) sera légitimé à cette occasion. Après la séparation, ce fils restera sous l'autorité de son père et Rosine Stoltz versera une pension pour son entretien (voir Le Droit, 27 mars 1844, p.323 et La Gazette des Tribunaux, 29 août 1857, p. 859).
[4] Illustrations: Rosine Stoltz (1815-1903) - BNF Richelieu, Musique fonds estampes, Stoltz R.
Société d'Histoire du Vésinet, 2005-2009 - histoire-vesinet.org